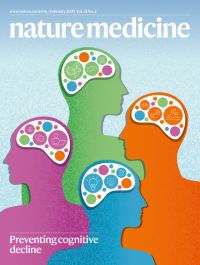Journal Club Mars 2025, analysé par Pierre-Louis Soubeyran (Institut Bergonié et Université de Bordeaux)
Symptom monitoring with electronic patient-reported outcomes during cancer treatment: final results of the PRO-TECT cluster-randomized trial.
Nat Med. 2025 Feb 7. doi: 10.1038/s41591-025-03507-y
Basch E, Schrag D, Jansen J, Henson S, Ginos B, Stover AM, Carr P, Spears PA, Jonsson M, Deal AM, Bennett AV, Thanarajasingam G, Rogak L, Reeve BB, Snyder C, Bruner D, Cella D, Kottschade LA, Perlmutter J, Geoghegan C, Given B, Mazza GL, Miller R, Strasser JF, Zylla DM, Weiss A, Blinder VS, Wolf AP, Dueck AC.
Ethan Basch, de l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill aux USA, est connu pour ses travaux sur le bénéfice des outils numériques pour la surveillance des patients en cours de traitement pour un cancer. Il a proposé que les patients enregistrent et qualifient eux-mêmes depuis leur domicile, à un rythme hebdomadaire, à partir de dispositifs numériques à leur domicile (smartphone, tablette ou ordinateur), les 12 symptômes les plus fréquemment observés. Ces résultats sont transmis immédiatement à l’hôpital qui les prend en charge, sous forme graphique, les situations les plus sévères étant mises en exergue selon des seuils d’alerte prédéfinis. Ethan Basch, ainsi que d’autres équipes, notamment françaises, ont montré que cette approche, comparée à une prise en charge standard (rendez-vous réguliers en consultation), améliore tant la survie globale que la qualité de vie des patients mais aussi diminue le recours aux services d’urgence voire réduit le risque de toxicité des traitements. L’explication du bénéfice est probablement l’intervention plus rapide des soignants, au rythme des symptômes décrits par les patients et non au rythme des consultations préprogrammées.
Il s’est également fortement investi dans le développement des PRO-CTCAE (Patient-Reported Outcomes Common Terminology Criteria for adverse events développés par le National Cancer Institute), évaluation des symptômes par les patients eux-mêmes au cours du traitement (et non par les médecins comme habituellement), à partir d’une liste exhaustive de domaines et non seulement 12 sélectionnés parmi les plus fréquents. C’est donc très logiquement qu’il a mis en place un essai pour valider l’intérêt de cette évaluation plus exhaustive des symptômes ressentis en cours de traitement, par les patients eux-mêmes, en utilisant les outils numériques. Il est important de noter que les patients ont été associés au design de l’outil, à la construction de l’essai, de sa réalisation, de l’analyse des résultats et que certains d’entre eux sont cosignataires de l’article.
La méthodologie mise en place est celle d’un essai randomisé de type cluster (ce sont les centres qui sont randomisés et non les patients) dans lequel 52 centres ont été randomisés entre une prise en charge standard (bras UC) et la collecte des PRO-CTCAE par un outil digital disponible à domicile pour les patients (bras PRO). Au total, 1191 patients ont été inclus dont 598 dans le bras UC et 593 dans le bras PRO. Il s’agissait de patients atteints de tous types de cancers, en situation métastatique, avec une indication de traitement médical, quel que soit le moment de leur prise en charge (au cours de différentes lignes de traitement) et quel que soit leur âge (médian : 63 ans, extrêmes : 28 à 93 ans). Une proportion significative de patients n’ayant jamais utilisé internet (16,9%) a été incluse. Les patients du bras PRO étaient sollicités à un rythme hebdomadaire pour indiquer les symptômes ressentis et classer leur niveau de sévérité. La majorité des patients ont choisi l’utilisation d’internet (ordinateur, tablette ou smartphone) (63,7%) plutôt qu’une interface téléphonique interactive (36,3%), ce dernier choix étant préféré par les patients ruraux, âgés ou ceux avec un niveau d’éducation plus bas. Le remplissage des questionnaires hebdomadaires a été aussi bon avec un moyen qu’avec l’autre puisque 91,5% des questionnaires sollicités ont été complétés mais la non complétion d’un questionnaire était suivi d’un rappel à 24h suivie éventuellement d’un appel d’un membre de l’équipe si le questionnaire n’était toujours pas rempli au bout de 3 jours.
Si l’objectif primaire d’augmentation de la survie globale n’a pas été atteint, l’essai n’en démontre pas moins de multiples bénéfices à plusieurs niveaux. On observe ainsi dans le bras PRO moins d’admissions aux urgences, moins de détériorations de la fonction physique, moins de symptômes et une meilleure qualité de vie. Les résultats restent significatifs si on analyse conjointement décès et détérioration.
L’incidence cumulée d’admission aux urgences à un an a ainsi été diminuée de 6,1% à un an (54,8% versus 48,7%, p = 0,03) avec un nombre moyen d’admissions par patient inférieur dans le bras PRO (1,02 versus 1,30, p<0,001). Le délai de détérioration de la fonction physique était plus long dans le bras PRO (12,6 versus 8,5 mois, p = 0,002). Il en est de même pour le contrôle des symptômes ou la détérioration de la qualité de vie.
Une évaluation de satisfaction des patients a été réalisée. Un total de 496 patients a complété un questionnaire de satisfaction à 3 mois et 245 en fin de traitement. La grande majorité des patients ont considéré l’outil comme pertinent et justifié pour leur prise en charge (91,4% à 3 mois, 90,3% en fin de traitement). Ils l’ont considéré facile à utiliser, qu’il permettait une amélioration des discussions avec l’équipe de soins et avait renforcé leur impression de contrôle de leur prise en charge (93,4%, 77% et 84% respectivement en fin de traitement). A terme, 91,4% le recommanderait aux autres patients pour accompagner leur prise en charge.